11 grands livres que vous n’avez probablement pas lus (mais que vous devriez lire)
L’une des choses qui me permet de tenir le coup pendant la pandémie est le maintien de mon sens de la découverte – avec tellement moins de façons de passer mon temps libre, et une obligation morale de rester aussi près de chez moi que possible, je me maintiens engagé en recherchant activement des livres, des films et de la musique dont je n’ai jamais entendu parler auparavant. Si ce n’est pas maintenant, quand ?
Donc à cette fin, cette semaine, j’ai demandé au personnel du Literary Hub de suggérer des livres qu’ils aiment et que personne – ou du moins le rhétorique » personne » qui signifie en fait » pas assez de gens » ou peut-être juste » personne que je connais » – n’a lu. Voici nos recommandations – et n’hésitez pas à nous faire savoir quels livres criminellement sous-lus vous avez cachés dans vos propres étagères dans les commentaires.
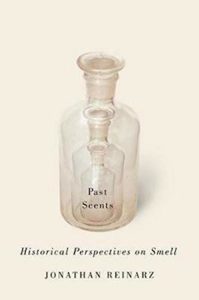
Jonathan Reinarz, Past Scents : Perspectives historiques sur l’odorat
Sans être exactement une lecture de plage, le livre de 2014 de l’historien de la médecine Jonathan Reinarz est une histoire culturelle engageante de ce qui est sans doute le plus méconnu des cinq sens. Reinarz montre comment les gens, de l’Antiquité à nos jours, ont utilisé les odeurs non seulement pour comprendre leur environnement physique immédiat, mais aussi pour juger si certains groupes de personnes méritaient d’être inclus dans une communauté. Les odeurs des personnes et des objets ont été utilisées pour déterminer la valeur et distinguer les pieux des païens, les blancs des gens de couleur, les femmes des hommes, et d’autres catégories. Selon Reinarz, le caractère insaisissable de l’odeur nous a conduits à négliger le rôle qu’elle a joué dans la définition des hiérarchies sociales dans le monde entier. -Aaron Robertson, rédacteur en chef adjoint
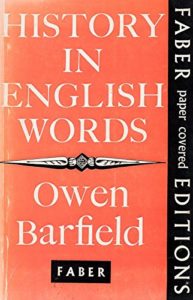
Owen Barfield, Histoire en mots anglais
Un dimanche d’été ennuyeux, quand j’avais 16 ou 17 ans, j’ai sorti un livre de poche très poussiéreux de la bibliothèque de mes parents. Ils étaient des bibliophiles d’une autre époque, celle d’avant le baby-boom, et possédaient des centaines de Faber délavés par le soleil et de Penguins cornés. Je ne me souviens pas pourquoi, exactement – peut-être était-ce le titre grandiose – mais je me suis senti obligé de m’asseoir sur le canapé avec un exemplaire de poche du milieu des années 50 de History in English Words d’Owen Barfield.
Premièrement publié en 1953, History in English Words était annoncé comme une « excursion historique à travers la langue anglaise », mais pour moi, c’était plutôt comme passer du temps avec un vieux parent éloigné dont l’immense connaissance des mots et de leurs origines se déroulait toujours, quel que soit le public. Barfield, un philosophe/philologue de formation, adopte une approche aimable et conversationnelle de l’étymologie, et travaille lentement sur la façon dont une terminologie spécifique et localisée fait son voyage métaphorique vers un usage plus large. Malheureusement, je n’ai pas un exemplaire avec moi, mais j’ai pu trouver quelques sections aléatoires sur Internet:
Beaucoup de ces premiers mots normands semblent avoir un caractère distinctif qui leur est propre, et même maintenant, après près de mille ans, ils se détachent parfois de la page imprimée avec un attrait particulier. C’est peut-être particulièrement vrai pour le vocabulaire militaire. Ce petit éclat vif, comme celui d’une vitre qui clignote juste après le coucher du soleil, qui appartient à l’ancien langage technique de l’héraldique, comme argent, azur, gueules, … semble parfois s’être répandu dans des mots normands plus courants – bannière, hauberk, lance, pennon, … et – si l’on est d’humeur – on peut même en apercevoir une lueur dans des termes quotidiens comme armes, assaut, bataille, forteresse, harnais, siège, étendard, tour et guerre. L’étymologie normano-française de couvre-feu est trop connue pour nécessiter un commentaire.
Trop connue ! Apprendre que le mot « couvre-feu » dérivait de ce moment de la nuit où le feu était couvert a soufflé mon esprit d’adolescent. Cela a changé ma vie de réaliser que le langage descriptif – la dénomination du monde – est totalement inextricable du langage métaphorique, qu’il existe un fossé poétique merveilleusement imparfait et trop humain entre les mots et les choses qu’ils décrivent. Franchement, c’est à Barfield que je dois mon diplôme de philosophie (j/k je suis tellement content de ne pas avoir fait économie ou politique ou ingénierie ou autre).
Il manque à ce livre, écrit pendant le tout dernier souffle de l’Empire britannique, une prise en compte des relations de pouvoir entre les langues, en particulier celle de la langue colonisatrice absorbant le vocabulaire du colonisé ; cela signifie que History in English Words est un texte de poétique plutôt que de politique, d’une époque où les deux étaient souvent – et très commodément – maintenus séparés. Néanmoins, ce livre a changé ma vie. -Jonny Diamond, rédacteur en chef

Michael Swanwick, La Fille du dragon de fer
La Fille du dragon de fer est, tout simplement, le roman de fantasy le plus cool que j’ai jamais lu, et pourtant il est épuisé depuis des années. Dans ce récit nihiliste, d’influence steampunk, de magie, de sang et de luxure, une ouvrière asservie dans une usine qui produit des dragons de fer mi-magiques, mi-industriels, aspire à s’échapper. Lorsqu’elle trouve un dragon de fer en panne, elle utilise son lien avec la créature pour s’enfuir de l’usine et se retrouve dans un village où les sacrifices humains, les centres commerciaux, la cocaïne, les rituels et les fêtes coexistent dans un paysage de banlieue bizarre. Elle se dirige ensuite vers la ville pour étudier l’alchimie, où elle doit également tenter de survivre aux régulières nuits de purge. Au fur et à mesure que ses pouvoirs augmentent, ainsi que sa colère contre les règles sévères du monde des fées, elle trouve que les restes de sa propre moralité s’effacent rapidement.
Les fans de Philip K. Dick, William Gibson et N.K. Jemisin adoreront cette prise de folie sur les tropes classiques de l’horreur populaire. De plus, Michael Swanwick a écrit ce livre parce qu’il trouvait qu’Anne McCaffrey faisait des dragons trop câlins, et il voulait évoquer les dragons comme des figures de terreur, ce qui est la meilleure raison d’écrire un roman de fantasy qui soit. Les dragons règnent en maîtres ! -Molly Odintz, rédactrice en chef de CrimeReads
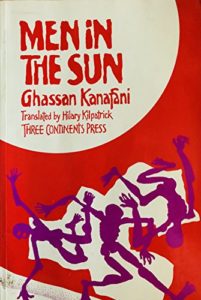
Ghassan Kanafani, tr. Hilary Kilpatrick, Des hommes au soleil
Le mince roman moderniste de Ghassan Kanafani raconte la vie de trois Palestiniens qui tentent de se faufiler au Koweït en se cachant à l’arrière d’un camion-citerne vide. Lorsque le conducteur splénétique du camion est attiré dans un bar en bord de route et se livre à une longue conversation sur sa virilité, les hommes cachés sont confrontés à un choix terrible : garder le silence et peut-être survivre, ou faire du bruit pour alerter les gens de leur lutte et risquer de se faire prendre, voire tuer. S’il existe une parabole politique plus puissante au cours des 50 dernières années, je ne l’ai pas lue. La vie de Kanafani s’est terminée brusquement lorsqu’il a été assassiné par le Mossad à Beyrouth en 1972 dans un attentat à la voiture piégée qui a également tué sa nièce de 17 ans. -John Freeman, rédacteur en chef
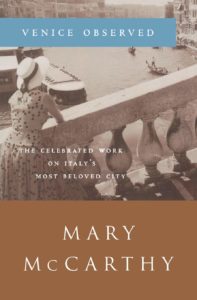
Mary McCarthy, Venice Observed
Au début de Venice Observed, Mary McCarthy reconnaît l’impossibilité d’écrire sur l’un des lieux les plus singulièrement aimés de la planète : « Rien ne peut être dit ici (y compris cette déclaration) qui n’ait été dit auparavant. » Néanmoins, au cours des 150 pages qui suivent, elle déroule divers épisodes de l’histoire de Venise d’une manière à la fois captivante, fascinante et précise, jusque dans les moindres détails. Ce livre de rêve, publié à l’origine en 1956 et réédité en 1963, s’est développé à partir d’essais publiés dans le New Yorker, et c’est un bon compagnon en tout temps, mais surtout dans notre réalité actuelle où les voyages sont limités. -Corinne Segal, rédactrice en chef
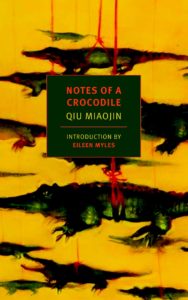
Qiu Miaojin, tr. Bonnie Huie, Notes of a Crocodile
L’année dernière, pour mon anniversaire, un ami très cher m’a offert les Notes of a Crocodile de Qiu Maiojin. (Bon, alors je suppose que ce n’est pas que personne d’autre ne l’a lu.) C’est l’un des livres les plus étranges, les plus merveilleux et les plus ludiques dans lequel je me suis surprise à pleurer. Il se déroule dans une université du Taipei des années 1980 et suit Lazi, une femme dangereusement amoureuse d’une autre femme. Leur relation est magnifique (« Peut-on recommencer ? Elle s’est retournée. L’océan a pleuré. Je savais que c’était un amour réciproque ») et torturée (« J’étais sur le point d’être éliminée du ring. Il était clair à partir de ce moment-là que nous ne serions jamais égaux. Comment pourrions-nous, avec moi sous la table, faire des pieds et des mains pour invoquer un autre moi, celui qu’elle vénérerait et mettrait sur un piédestal ? »), comme toute bonne histoire d’amour addictive. L’ombre de leur relation continue à hanter notre héroïne alors qu’elle navigue entre de nouvelles amitiés et le reste de son temps à l’école.
Mais, lecteur, l’écriture – tendrement traduite par Bonnie Huie – vous donnera envie de tout souligner : » J’espérais entrevoir d’autres âmes sœurs se tenant nues sur leurs propres balcons. c’est comme ça, écrire une œuvre littéraire sérieuse. » (Si vous aussi, vous êtes un fan de Jeanette Winterson – pour ses histoires d’amour queer, pour son style hybride et audacieux – vous allez adorer ce livre). Et ne me lancez pas sur le crocodile. (Oui, entre les entrées de notre narrateur qui ressemblent à un journal intime, nous entendons le crocodile éponyme. C’est surréaliste. C’est une satire. Il se cache parmi les humains, de peur d’être découvert). -Katie Yee, rédactrice adjointe de Book Marks
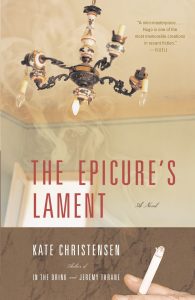
Kate Christensen, The Epicure’s Lament
Je ne comprendrai jamais pourquoi plus de gens ne a) lisent pas et b) ne parlent pas de ce roman de 2004, que j’ai lu il y a plus de dix ans et auquel je pense encore chaque semaine. Comment ne pas penser au délicieux misanthrope, au délire furieux, à l’entêtement meurtrier d’Hugo Whitter, un poète raté qui va officiellement mourir s’il n’arrête pas de fumer, mais qui se terre dans le manoir en ruine de sa famille et refuse, refuse absolument de le faire. Si seulement tout le monde le laissait mourir, seul, en paix ! Mais ils ne le feront pas, et vous ne voudrez jamais qu’ils le fassent, parce que cela signifie que vous devrez arrêter de lire les observations parfaites et morveuses d’Hugo, ses insultes vicieuses et hautaines, et les confessions à peine cachées de ses désirs mécontents. C’est magique. -Emily Temple, directrice de la rédaction

Simone Schwarz-Bart, tr. Barbara Bray, Le pont de l’au-delà
Le pont de l’au-delà de Simone Schwarz-Bart (traduit par Barbara Bray) offre un portrait saisissant des jours toujours changeants, lents et moites de la vie en Guadeloupe. Publié en 1972 sous le titre Pluie et vent sur Télumée miracle, et réédité en 2013 avec une introduction de Jamaica Kincaid, Le pont de l’au-delà suit Télumée qui raconte l’histoire de sa vie, en commençant non pas par son enfance mais par son arrière-grand-mère Minerva, qui faisait partie de la génération des nouveaux affranchis à l’époque de l’esclavage. Télumée vit sa vie dans les rêves – des rêves de promesse, d’évasion et de sanctuaire, qui alimentent ses propres visions sanguines du monde et de sa place dans celui-ci. Guidée par les paroles sagaces de sa grand-mère Toussine (qui se fait appeler Reine sans nom), Télumée parvient à ne pas glisser dans des rêves qui se transforment parfois en cauchemars et trouve plutôt la joie dans les mystères et l’opacité de la vie.
Le Pont de l’au-delà est rempli de phrases riches – des phrases qui se déversent magnifiquement les unes dans les autres, émettant le chant des environs et de l’histoire de la Guadeloupe. Nous apprenons que les mots sont à la fois prophétie et rituel, et la magie du roman émerge finalement non seulement d’un œil attentif mais aussi d’une oreille ouverte. The Bridge of Beyond est une œuvre qui vous frappe à la tête et vous dit : hé, regardez ce que la fiction peut faire. -Rasheeda Saka, Editorial Fellow
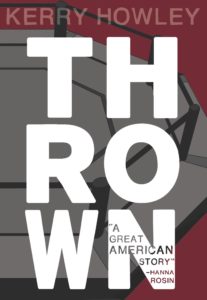
Kerry Howley, Thrown
Thrown-Kerry Howley’s 2014 œuvre hybride de journalisme de combat d’immersion, d’enquête philosophique et de mémoire partiellement romancée-est confortablement le livre de sport le plus intéressant que j’ai jamais lu, et je dis cela en tant que personne qui aime l’écriture sportive mais (le film criminellement sous-estimé Warrior 2011 mis à part) n’a pas vraiment de temps pour le MMA. S’éloignant d’une conférence universitaire aride à Des Moines, la narratrice (une version hyper-ruminative et cérébrale de Howley, nommée « Kit ») se retrouve dans la foule lors d’un match en cage, complètement envoûtée par « le genre de boucherie honnête auquel les académiciens de la théorie et de la logique que je venais d’abandonner ne participeraient jamais ». À partir de là, elle s’insinue dans la vie de deux combattants en marge de la réussite dans ce sport alors marginal – l’un est un vétéran meurtri, l’autre un jeune espoir arrogant – alors qu’ils se détruisent et se refont chaque jour dans la salle d’entraînement et dans l’octogone. Portraitiste et parasite, confident et disciple, anthropologue aux yeux vifs et fan inconditionnel, le Kit de Howley capture la sauvagerie balle au pied des sports de combat, et notre quête de moments de transcendance au sein de leur brutale carnalité, comme rien d’autre que je n’ai rencontré auparavant ou depuis. -Dan Sheehan, Book Marks Editor

Dorothy Baker, Cassandra at the Wedding
Le livre que je ne cesserai jamais de recommander à tout le monde dans ma vie, y compris aux lecteurs de Lit Hub, s’appelle Cassandra at the Wedding, écrit en 1962. C’est l’histoire d’une jeune femme qui rentre chez elle pour l’occasion redoutée du mariage de sa sœur jumelle identique Judith, et n’a aucun rapport avec le film d’Anne Hathaway, Rachel au mariage, même s’ils semblent similaires d’après cette description. Le livre est l’histoire d’amour de Cassandra et Judith, avec toute la comédie et la tragédie que comporte une histoire d’amour digne de ce nom.
Je pense quotidiennement au piano de ce livre : les jumelles vivaient ensemble à Berkeley et ont décidé d’en acheter un, bien avant que Judith ne parte et ne rencontre son mari. « On devrait vivre comme ça, tu ne crois pas ? » dit l’une à l’autre ; elles ont une vingtaine d’années, et elles décident de passer leur vie ensemble, juste elles et leur piano. Le piano peut être une métaphore, bien sûr, mais il est aussi tout simplement lui-même, son aspect tangible, grandiose et robuste. Ils ont choisi leur vie. Ils ont choisi le piano, et ils ont choisi de le partager, d’en partager le coût équitablement, même si Judith était la seule à pouvoir en jouer. C’est un livre qui brise le cœur. Il s’agit d’aimer trop, de donner trop, et d’attendre trop, et ce genre d’amour étant la seule option possible.
Sur le plan personnel, j’ai beaucoup (bizarrement beaucoup) de meilleurs amis qui sont jumeaux et voir une description aussi complexe de ce genre de lien était tout simplement le seul de ce genre que j’ai jamais lu. Mais même pour ceux d’entre nous qui ne sont pas nés avec le lien des jumeaux identiques, nous pouvons avoir ces mêmes attachements pour les autres, meilleurs amis et amants, et ce sera toujours la même brutalité de découvrir qu’ils ne vous ont jamais aimé comme vous les avez aimés. Cassandra et Judith ont partagé le piano, et elles ont partagé une vision de leur vie, du moins pendant un temps. Mais ensuite, Judith s’est détachée de cette vision, est partie seule et a trouvé quelqu’un d’autre, et a laissé Cassandra seule avec ça : avec la moitié d’une vie, et la moitié d’un piano, qui ressemble beaucoup à un piano entier, mais qui ne l’est pas. -Julia Hass, membre de la rédaction
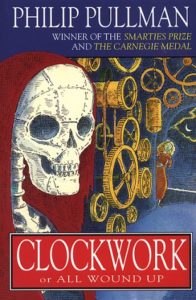
Philip Pullman, Clockwork
L’une de mes lectures d’enfance préférées était le chapter book de Philip Pullman, Clockwork, possédant une histoire enchanteresse et de nombreuses illustrations au fusain obsédantes pour l’accompagner. Clockwork a été la première métafiction à laquelle je me suis intéressée. Elle commence dans une ville allemande tranquille connue pour ses figurines d’horlogerie, où l’écrivain de la ville raconte une histoire dans la taverne locale, tandis que l’apprenti horloger de la ville redoute de révéler qu’il n’a pas réussi à terminer sa pièce d’apprentissage. Dans l’histoire dans l’histoire, un roi et son fils reviennent d’une partie de chasse désastreuse ; le roi meurt, et le prince a été remplacé par une parfaite réplique d’horloge qui doit trouver l’amour pour devenir réelle. L’écrivain n’a pas de fin à son conte, alors son histoire prend vie pour se terminer elle-même, un rebondissement qui m’a complètement époustouflé quand j’étais enfant.
Lorsqu’un horloger maléfique du conte de l’écrivain apparaît dans le village et donne à l’apprenti un chevalier d’horlogerie à revendiquer comme sa propre œuvre, et que le prince arrive pour trouver du réconfort pour son cœur d’horloger, une grande confrontation s’ensuit, pour l’un des contes d’enfance les plus magiques jamais créés. Je n’ai vraiment aucune idée de la raison pour laquelle les autres œuvres de Pullman sont si connues, alors que Clockwork se morfond dans l’obscurité, et j’espère que quelques-uns de ceux qui liront ce tour d’horizon décideront de découvrir ses charmes féeriques par eux-mêmes. -Molly Odintz, Rédacteur en chef de CrimeReads
Leave a Reply